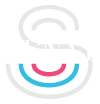Lorsqu’on prend la peine de considérer froidement le fil des événements de l’année 2025, un constat s’impose avec une évidence presque dérangeante : cette année a été, objectivement, calme et relativement sereine. Pas d’émeutes majeures, pas d’attentats frappant le territoire, pas de catastrophe climatique d’ampleur exceptionnelle, pas de grèves durables paralysant le pays, pas d’épidémie dévastatrice bouleversant la vie quotidienne. Après une décennie marquée par des chocs successifs – terrorisme, pandémie, inflation, guerre aux portes de l’Europe –, 2025 apparaît presque comme une parenthèse de normalité retrouvée.
Et pourtant, jamais le moral des Français n’a semblé aussi bas. Les enquêtes d’opinion dressent un tableau sans appel : 85 % d’entre eux estiment que 2025 a été une mauvaise année. Un chiffre qui place la France en tête, à égalité avec la Corée du Sud, du classement mondial des peuples les plus pessimistes. Pour l’année à venir, seuls 41 % des Français se disent optimistes, quand la moyenne mondiale atteint 71 %. S’agissant de l’économie, à peine 21 % anticipent une amélioration de la conjoncture, contre 49 % au niveau international. Le décalage est vertigineux.
Plus surprenante encore est la hiérarchie des inquiétudes exprimées. En tête des préoccupations, à 47 %, figure l’instabilité politique. Vient ensuite, à 40 %, le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis. Or, ces sujets, aussi importants soient-ils sur le plan géopolitique ou institutionnel, n’ont pas d’impact direct et tangible sur la vie quotidienne de la majorité des Français. Les niveaux de vie ne basculent pas brutalement sous l’effet de ces événements. Les riches restent riches, les pauvres restent pauvres – tragiquement, mais sans bouleversement soudain. Les services publics fonctionnent, les salaires sont versés, les écoles ouvrent, les hôpitaux soignent.
D’où viennent alors ce malaise diffus, cette impression de déclin permanent, cette conviction que l’avenir est condamné à être sombre ? Une partie de la réponse réside sans doute dans le climat discursif qui s’est imposé progressivement dans l’espace public. Depuis plusieurs années, le langage, politique comme médiatique, s’est chargé d’une tonalité de plus en plus martiale. La guerre est invoquée à tout propos. Guerre contre le Covid hier, guerre contre le narcotrafic aujourd’hui, guerre contre l’islamisme, contre l’inflation, contre le réchauffement climatique. On parle d’économie de guerre, de guerre commerciale, de guerre économique, de guerre informationnelle. Le lexique militaire est devenu un réflexe, une facilité rhétorique, un outil de dramatisation permanente.
Ce recours incessant à la métaphore guerrière n’est pas anodin. À force de présenter chaque difficulté comme un combat existentiel, chaque réforme comme une bataille décisive, chaque désaccord comme un affrontement, on instille l’idée d’un état d’urgence permanent. Or l’urgence constante fatigue, use, angoisse. Elle empêche la projection sereine dans l’avenir. Elle entretient un sentiment d’insécurité abstraite, déconnectée des réalités vécues, mais psychologiquement très puissante.
La confusion est d’autant plus grande que la guerre réelle – celle qui tue, qui détruit des villes, qui jette des familles entières sur les routes de l’exil – ne sévit pas en France. Fort heureusement. Assimiler, par le langage, des défis politiques, économiques ou sanitaires à des conflits armés revient à banaliser la guerre tout en dramatisant à l’excès des difficultés qui, pour sérieuses qu’elles sont, relèvent du débat démocratique et de l’action publique ordinaire.
Cette dérive confine parfois à l’absurde, comme en témoigne l’usage de formules paradoxales telles que le « réarmement démographique », oxymore troublant qui associe implicitement l’idée de la naissance à celle de la destruction. À force de manier ces images, on finit par brouiller les repères, par installer un imaginaire de confrontation perpétuelle qui pèse lourdement sur les consciences collectives.
Les réseaux sociaux jouent, à cet égard, un rôle amplificateur considérable. Algorithmes de l’indignation, cycles de polémiques incessantes, mise en avant systématique du conflictuel et du catastrophique : tout concourt à enfermer les citoyens dans une vision dégradée du monde. Les médias traditionnels, pris dans la logique de l’audience continue, ne sont pas exempts de responsabilité. Le spectaculaire l’emporte trop souvent sur la mise en perspective, l’émotion sur la raison, l’exception sur la règle.
En ce début d’année, il est permis – et souhaitable – de formuler un vœu simple mais exigeant : celui du discernement. Se défaire, au moins partiellement, de la dépendance aux flux numériques anxiogènes. Prendre de la distance avec des discours qui, volontairement ou non, suggèrent l’idée d’une guerre sans fin. Réapprendre à distinguer les risques réels des peurs entretenues, les menaces concrètes des inquiétudes abstraites.
La France ne va pas si mal. Elle n’est ni en ruines, ni au bord de l’effondrement. Elle traverse, comme toutes les démocraties avancées, une période de transition et de tensions, mais elle dispose d’atouts considérables : institutions solides, économie résiliente, cohésion sociale imparfaite mais réelle. Reconnaître cette réalité n’est ni un acte de naïveté ni un déni des difficultés. C’est, au contraire, une condition essentielle pour retrouver la confiance nécessaire à l’action collective et à l’avenir. C’est aussi ne pas céder à la facilité du pire et endosser cette « âme forte, audacieuse, téméraire » qui, pour Nietzsche, fait avancer, « l’œil calme et le pas ferme ».
Très bonne année à toutes et tous.
Hugues Saury
Olivet, le 1er janvier 2026